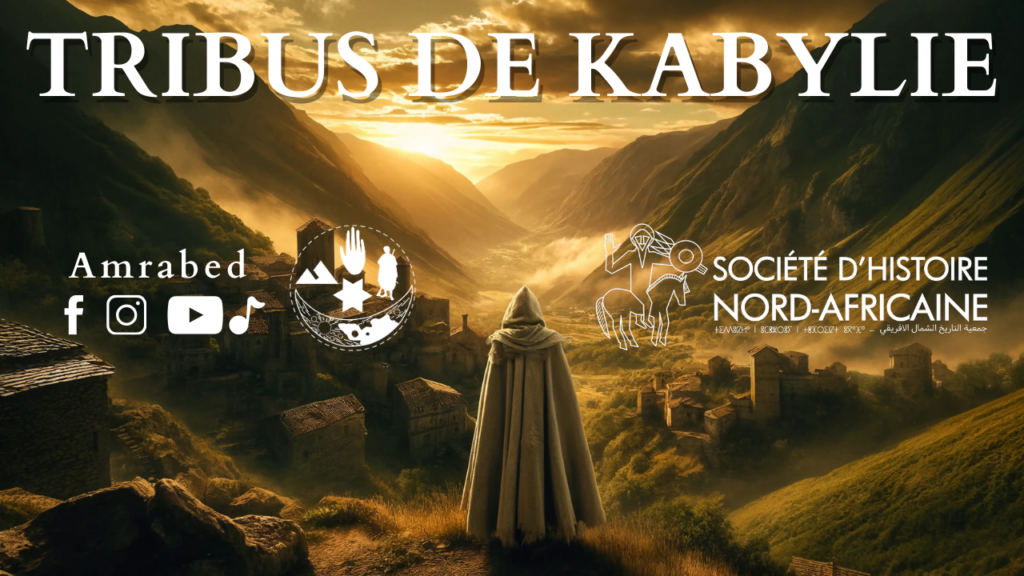Par Salim Djoudi (2025)
Mots clés : tribus, confédérations, Kabylie
Plan
Appellations
Marché
Découpage administratif
Aujourd’hui
Texte intégral
La société kabyle était jadis constituée d’une mosaïque de fractions, de tribus, de confédérations, de villages indépendants et, parfois, même de familles vivant en dehors du village. Les familles, ou tiwaculin, formaient des sortes de clans, que l’on désigne en kabyle par adrum, taxerrubt ou taɛrif. Ces trois termes peuvent être des synonymes ou désigner des formes de clans différentes selon les régions. Un clan, qui est en quelque sorte une grande famille, peut à lui seul former un village, que l’on appelle plutôt taxlict. Le regroupement de plusieurs petits villages de ce genre forme ce que l’on appelle en kabyle ttufiq. Aujourd’hui, la majorité de ces ttufiq se sont unis pour ne former qu’un seul grand village. Le village, qui peut être une union de plusieurs tixlicin ou un seul village comprenant deux ou plusieurs clans, est nommé en kabyle taddart. C’est le village qui formait jadis l’unité politique en Kabylie, chaque village s’autogérant de manière indépendante, séparé de ses voisins. Toutefois, plusieurs villages peuvent s’unir pour former une unité politique plus importante, désignée en kabyle sous le terme lɛerc, que l’on traduit en français par « tribu ».
Lɛerc, au sens propre du terme, ne désigne pas vraiment la tribu telle qu’on l’entend en français, mais plutôt une sorte de ligue politico-militaire, une alliance entre plusieurs villages. Or, tout comme plusieurs villages peuvent s’unir pour former une tribu, pour des raisons d’ordre défensif, plusieurs tribus peuvent également s’unir pour former une ligue plus importante, qui prend en kabyle le terme taqbilt, que l’on traduit en français par « confédération tribale ».
outes les tribus n’adhèrent pas forcément à ces ligues, que sont les confédérations, tout comme tous les villages n’adhèrent pas à des tribus. Il existe des cas, certes rares, de villages qui restent étrangers à toute alliance, qui ne font partie d’aucune tribu, et qui forment une tribu à eux seuls. Ce sont souvent des villages de marabouts, qui ne prennent pas part aux guerres et qui n’ont pas de préoccupations militaires. Ce sera par exemple le cas des Chorfa (Cceṛfa) de l’Oued Sahel, des Aït Sidi Ayad (At Sidi Ɛiyad) de la Soummam, et des Chorfa Guighil Guiken (Cceṛfa n Yiɣil n Yiken) du Bassin de Boghni. Mais c’est également le cas des Ighil Imoula (Iɣil Imula), qui ne sont pourtant pas des marabouts. On dira en kabyle que tel village forme une tribu à part : taddart-nni d lɛerc iman-is.
Pour bien comprendre la terminologie utilisée, tant dans cet article que dans les articles précédents et ceux à venir, on parle de tribu confédérée lorsqu’il s’agit d’une tribu faisant traditionnellement partie d’une confédération, d lɛerc i yellan deg kra n teqbilt, tandis qu’une tribu non confédérée est une tribu qui n’adhère à aucune confédération, d lɛerc u nelli ara deg kra n teqbilt, sachant que l’écrasante majorité des tribus de Kabylie ne sont pas confédérées.
Toutes les confédérations de Kabylie se trouvent dans les wilayas de Tizi Ouzou et de Boumerdès. Une seule confédération incertaine, dont je n’ai pas encore pu bien localiser le territoire, se trouve en Petite Kabylie, dans la wilaya de Sétif. Il s’agit de la confédération des Amoucha (Iɛemmucen).
On trouve onze confédérations en Grande Kabylie : la plus grande est celle des Flissa Ou Mellil (Iflisen Umellil), qui compte quatorze tribus. Il y a aussi les Aït Ouagenoun (At Wagnun) avec huit tribus, les Flissa El Bahr (Iflisen n Lebḥaṛ) avec quatre tribus, les Aït Djennad (At Jennad) avec trois tribus, les Maatkas (Lemɛatqa) avec trois tribus, les Guechtoula (Igucdal) avec six tribus, les Aït Aissi (At Ɛisi) avec sept tribus, les Aït Sedka (At Sedqa) avec sept tribus, les Aït Iraten (At Iraten) avec cinq tribus, et enfin le cas particulier des Igawawen, qui forment une grande confédération de huit tribus, elle-même composée de deux confédérations secondaires de quatre tribus chacune : les Aït Betroun (At Betrun) et les Aït Menguellet (At Mengellat). Ce qui fait un total de soixante-cinq tribus confédérées.
Les rapports entre les différentes tribus d’une même confédération varient d’une confédération à l’autre. Les tribus des Igawawen sont très indépendantes les unes des autres et se faisaient souvent la guerre entre elles jadis. Il en va de même pour les Aït Aïssi (At Ɛisi), qui ne partagent même pas le même accent. Tandis que les Aït Iraten (At Iraten), les Aït Ouagenoun (At Wagnun) et les Flissa El Bahr (Iflisen n Lebḥaṛ) paraissent, quant à eux, plus homogènes. La confédération, en tant qu’entité politique, avait plus de poids chez ces derniers, tandis que chez les Igawawen et les Aït Aïssi (At Ɛisi), par exemple, la confédération n’existe réellement qu’en période de guerre. Les tribus se désunissent, se déconfédèrent, si l’on peut dire, aussitôt que la paix est rétablie.
Les frontières entre les tribus, et parfois même entre les confédérations, sont souvent des frontières linguistiques. Les villages des différentes tribus ont souvent le même accent, et parfois un accent spécifique à chaque tribu. La limite entre les deux confédérations qui forment Igawawen est justement une frontière linguistique : entre ceux qui prononcent le son Ɛ et ceux qui ne le prononcent pas, entre ceux qui disent sɛiɣ et ceux qui disent seɣ. Il en va de même pour la frontière entre les Aït Aïdel (At Ɛidel) et les Aït Abbas (At Ɛebbas), qui marque la limite entre deux accents : ceux qui disent yewwi-d, wayi, yewweḍ, et ceux qui disent yeggʷi-d, wagi, yeggʷeḍ. On notera au passage que l’accent des Aït Aïdel (At Ɛidel) est précisément nommé Taɛidelt, car il leur est propre et correspond parfaitement aux limites de leur tribu. Il en est de même pour l’accent des Aït Melloul (Ayt Mellul), situé à cheval entre l’accent bougiote et Tasaḥlit, qui est nommé Tamellulit et est spécifique aux Aït Melloul (Ayt Mellul).
Appellations
Par rapport aux appellations, certaines tribus se nomment sous une forme plurielle, comme par exemple les Ferdioua (Iferdiwen), les Hasnaoua (Iḥesnawen), les Illoula (Illulen), les Flissa (Iflisen), les M’cisna (Imsisen), les Nezliwa (Inezliwen)… et la liste est longue. Quelques rares tribus ont une appellation arabe, c’est le cas par exemple des Frikat (Friqat), des Mâatka (Lemɛatqa) et des Abid (Leɛbid). Mais dans la majorité des cas, le nom des tribus et des confédérations est précédé du terme Aït, qui a trois prononciations différentes en kabyle : Ayt chez les Isahliyen, dans le cercle de Bougie et en Kabylie occidentale ; It dans la partie orientale des Bibans et des Babors d’Akbou ; et At, qui est la forme majoritaire partout ailleurs en Kabylie. On aura par exemple Aït Smael (Ayt Smaɛel) chez les Isahliyen et Aït Smael (At Smaɛel) dans la région de Boghni, Aït Amrane (Ayt Ɛemran) près de Béjaia et Aït Amrane (At Ɛemran) chez les Flissa Ou Mellil (Iflisen Umellil), Aït Yaala (It Yeɛla) dans les Bibans et Aït Yaala (At Yeɛla) dans la wilaya de Bouira. On aura également Aït Brahem (It Bṛahem), Aït Ourtilane (It Wertiren), Aït Yadel (It Yeɛdel), tandis que plus au nord ce sera Aït Slimane (Ayt Sliman), Aït Bimoun (Ayt Bimun), Aït Tamzalt (Ayt Temẓalt), et ailleurs Aït Aïdel (At Ɛidel), Aït Ouacif (At Wasif), Aït Iraten (At Iraten). Il y a également des tribus qui ont aussi bien la forme plurielle que la forme avec Aït. C’est le cas par exemple des Aït Amrane (Ayt Ɛemran), qui sont également appelés Iɛemranen, des Aït Boudrar (At Budrar), qui sont également appelés Iboudraren (Ibudraren), et des Aït Attaf (At Ɛeṭṭaf), qui sont également appelés Yattafen (Iɛeṭṭafen).
Avertissement
Au passage, j’aimerais vous conseiller de ne pas vous fier aux sources coloniales concernant les tribus et les confédérations de Kabylie. Des tribus arabophones, comme la confédération des Isser et les Beni Tour de Dellys, sont citées par les Français comme étant des tribus kabyles, tandis que d’autres tribus, bel et bien kabyles, ne figurent pas dans les inventaires des sources coloniales, telles que les Ammal (Iɛemmalen), les Khachna du côté de Béni Amrane, et les Amoucha (Iɛemmucen).
Marché
Les tribus avaient souvent un marché hebdomadaire, qui prenait le nom du jour de la semaine durant lequel il se tenait. On aura par exemple Djemaa Saharidj (Lǧemɛa n Sariǧ) le vendredi chez les Aït Fraoucen (At Fṛawsen), Ssebt n Ayt Sliman le samedi chez les Aït Slimane (Ayt Sliman), Lḥedd Wakli le dimanche dans la tribu de Toudja, Letnayen n Ilmayen le lundi chez les Aït Yadel (It Yeɛdel), Tlata n Lḥemam le mardi chez les Aït Menguellet (At Mengellat), Larebɛa n It Ɛfif le mercredi chez les Aït Chebana (It Cbana), et Lexmis n Tensawt le jeudi chez les Aït Aïdel (At Ɛidel).
Il arrive qu’une tribu possède plusieurs marchés, mais ce cas ne s’observe que chez les grandes tribus prospères de Petite Kabylie. Par exemple, les Aït Yadel (It Yeɛdel) en ont deux, les Aït Chebana (It Cbana) en ont trois, et la puissante tribu des Aït Abbas (At Ɛebbas), la plus grande tribu de Kabylie, en possède quatre, dont deux se tiennent le même jour. Ce sont d’ailleurs généralement ces mêmes tribus qui donnent l’impression d’être des confédérations, tant leur superficie est grande et tant leurs fractions se comportent comme des tribus à part. On dira, par exemple, lɛerc n It Ǧeɛfer pour parler de la fraction des Aït Djaafer chez les Aït Yadel (It Yeɛdel). On dira également lɛerc n It Nuḥ chez les Aït Aïdel (At Ɛidel), lɛerc n Buǧlil chez les Aït Abbas (At Ɛebbas), et lɛerc n It Ɛfif chez les Aït Chebana (It Cbana).
Découpage administratif
Pour des raisons administratives, l’administration coloniale réorganisa le découpage territorial de la Kabylie, ce qui bouleversa profondément l’organisation tribale. Nombre de tribus furent frappées de séquestre, et leurs terres amputées pour y édifier des villages de colonisation : ainsi, les territoires d’Azazga et de Yakouren chez les Aït Ghobri (At Ɣebri), celui d’Akbou chez les Illoula Oussameur (Illulen Usamar), celui de Bougie chez les Mezzaia (Imezzayen), de Port Gaydon (actuelle Azeffoun) chez les Zakhfaoua (Izerxfawen), et de Seddouk chez les Aït Aïdel (At Ɛidel). Les territoires dits indigènes, qui ne furent pas séquestrés, furent alors organisés en douars. Certains de ces douars respectèrent les limites des tribus, et prirent même leur nom, comme celui de Beni Yenni, qui reprend le territoire de la tribu des Aït Yenni (At Yenni). Cependant, dans de nombreux cas, les petites tribus furent totalement supprimées, soit regroupées en un seul douar, comme ce fut le cas pour les Ighil Imoula (Iɣil Imula) et les Chorfa Guighil Guiken (Cceṛfa n Yiɣil n Yiken), soit rattachées simplement au douar d’une tribu plus importante, comme les Aït Sidi Ayad (At Sidi Ɛiyad), rattachés aux Aït Immel (At Yemmel). Il en alla de même pour les grandes tribus, qui furent découpées en plusieurs douars, telles que les Aït Aïdel (At Ɛidel), les Aït Khalfoun (Ayt Xelfun), les Aït Abbas (At Ɛebbas) et les Aït Slimane (Ayt Sliman).
Ainsi, les tribus des Babors d’Akbou, la partie montagneuse située entre les Babors et la Soummam – nous aurons l’occasion de parler de la géographie de la Kabylie plus en détail dans une prochaine vidéo – je disais que les tribus de cette région ont été regroupées dans les cartes des Archives Nationales d’Outre-Mer en deux grandes confédérations : la Confédération des Ouled Abdeldjebbar au nord et celle de Larache (Leɛrac) au sud. Or, la première confédération correspond simplement aux territoires contrôlés par la famille des Aït Ou Rabah, et la deuxième englobe les terres contrôlées par Si Mohand Cherif Ameziane. Autrement dit, il s’agit de confédérations créées par l’administration coloniale autour de deux chefs locaux promus au rang de Bachagha, alors que, dans les faits, aucune confédération au sens propre du terme n’existait dans cette région. Cela a eu pour effet d’effacer de la mémoire collective une partie des tribus de la première confédération, notamment celles autour de Berbacha (Ibeṛbacen), et pour la deuxième, d’effacer de la mémoire l’ancienne tribu des Aït Khiar (It Xiyaṛ) pour la remplacer par deux appellations purement administratives : les habitants de cette région se disent aujourd’hui et sont nommés par leurs voisins soit Aït ou Maouche (It Umɛuc), ou Beni Maouche, soit Larache (Leɛrac), les deux dernières étant des appellations purement administratives.
Le découpage administratif a également fait des siennes en Grande Kabylie, et j’aimerais dire surtout en Grande Kabylie. Sur les huit tribus qui composent Igawawen, sept ont une commune à leur nom, seule la petite tribu des Aït Bou Akkach (At Bu Ɛekkac) n’a pas eu de privilège, or, rare sont ceux aujourd’hui qui se souviennent de cette tribu, ses habitants se disent aujourd’hui d’Aït Ouacif (At Wasif), car trois de leur villages ont justement été rattachés à la commune de Ouacif, tandis que le dernier fait partie de la commune d’Aït Boumahdi. Cette même commune de Ouacif, dont les limites ne respectent en rien les frontières de l’ancienne tribu des Aït Ouacif (At Wasif), alors que les limites de la commune voisine de Beni Yenni correspondent, quant à elles, assez bien à celles de l’ancienne tribu des Aït Yenni (At Yenni).
Aujourd’hui
Aujourd’hui, l’appartenance aux anciennes tribus sert plutôt de repère géographique. Suivant les régions, on se définit comme appartenant à telle tribu ou à telle commune, on reconnaît un tel comme étant d’une telle tribu selon son accent, on dira d’une personne qui dit timellarin, si nous sommes à Tizi Ouzou, que winna d amɛatqi neɣ n At Zmenzer ; d’une personne qui dit timellajin, si on se trouve aux Ouadhias (Iwaḍiyen), que winna n At Argan ; d’une personne qui dit yewweḍ, si on se trouve à Akbou, que winna d aɛidel.
Dans certaines régions, on se souvient encore parfaitement de sa tribu, tandis que dans d’autres, certaines tribus sont passées aux oubliettes, supplantées par le découpage administratif. Dans certains cas, comme chez Igawawen, on se rappelle encore très bien des tribus, mais on a perdu la mémoire de la confédération qu’elles composaient. À l’inverse, chez les Aït Iraten (At Iraten) et les Aït Djennad (At Jennad), les habitants se souviennent parfaitement de leur confédération et se définissent comme étant d’iratniyen ou d’ijennaden, mais ont complètement oublié les tribus qui composaient ces deux confédérations.
Pour citer cet article
Salim Djoudi, « Tribus et confédérations de Kabylie », Société d’Histoire Nord-Africaine (SHNA), 2025
Article en vidéo
Bibliographie
- Allioui Youcef. Les Archs, tribus berbères de Kabylie: histoire, résistance, culture et démocratie. Paris : L’Harmattan, 2006.
- Mahé Alain. Histoire de la Grande Kabylie XIXe-XXe siècles : Anthropologie historique du lien social dans les communautés villageoises. Saint-Denis : Éditions Bouchène, 2001.